
L’or dépasse pour la première fois les 5000 dollars l’once !
Le cours de l’or a atteint, dans la nuit du 25 au 26 janvier...
Pendant des millénaires, l’or a fasciné les dirigeants et servi de gage suprême de richesse. Depuis l’Antiquité, les cités et empires accumulent l’or dans des trésors sacrés ou royaux. Athènes, par exemple, conserva au Ve siècle av. J.-C. un imposant trésor sur l’Acropole, la statue chryséléphantine d’Athéna Parthénos au Parthénon, qui était revêtue de plaques d’or pur pour près d’1,3 tonne d’or. Ce pactole servait de réserve financière ultime pour la cité d’Athènes. Plus tard, le légendaire roi Crésus de Lydie au VIᵉ siècle av. J.-C., accumula tant d’or que son nom est passé en proverbe : riche comme Crésus. Plus à l’est, l’Empire perse achéménide entassa le butin de ses conquêtes, tout comme Rome qui, à la fin de la République, s’appropria les trésors hellénistiques. Ainsi, de l’Égypte pharaonique dont les tombes regorgeaient d’or, aux cités grecques, l’or fut l’arme silencieuse, plus décisive que bien des épées.

Au Moyen Âge, l’or reste rare en Europe occidentale, mais demeure l’apanage des empereurs et des rois. Les Byzantins utilisent le solidus d’or comme monnaie stable et Charlemagne lui-même fait frapper des mancus d’or. Les royaumes médiévaux thésaurisent leurs pièces et objets d’or, souvent acquis par le commerce ou la guerre. Les Croisades rapportent en Occident des trésors byzantins et orientaux récupérés lors le sac de Constantinople en 1204 qui vit les croisés piller icônes et vases d’or en quantité. Parallèlement, les échanges avec l’Afrique transsaharienne apportent de l’or du Soudan, une région de l’actuel Mali, en Europe. En 1324, le pèlerinage du roi Mansa Musa de l’Empire du Mali vers La Mecque stupéfia le monde musulman, il distribua tant d’or en chemin que le prix du métal précieux chuta au Caire pendant quelques années, signe d’une opulence inouïe.
Durant la Renaissance, avec les conquêtes coloniales, l’Europe découvre de nouvelles mines d’or. Du côté des empires aztèque et inca, ils sont dépossédés de leurs réserves. Ainsi en 1532, l’empereur inca Atahualpa offrit une salle remplie d’objets d’or en rançon, un butin fabuleux que les conquistadors fondirent en lingots. Les galions espagnols du XVIᵉ siècle rapportent ainsi des tonnes d’or, et surtout d’argent, du Nouveau Monde, finançant les monarchies d’Europe et attisant les convoitises. Les trésors amassés par les couronnes européennes en Espagne, Portugal, puis Angleterre et France deviennent dès lors des réserves stratégiques.
Au XIXᵉ siècle, l’or prend une dimension nouvelle avec l’ère de l’étalon-or. À partir des années 1800, de grandes découvertes en Californie en 1848, en Australie en 1851 et en Afrique du Sud en 1886, inondent le marché mondial de métal jaune. Les banques centrales commencent à accumuler l’or pour garantir la valeur des monnaies émises. Le Royaume-Uni adopte officiellement l’étalon-or en 1816, bientôt suivi par la plupart des puissances industrielles. Détenir de l’or devient alors indispensable pour inspirer confiance et la devise papier est alors échangeable en or sur demande. Vers 1900, les réserves d’or des banques centrales européenne et américaine atteignent des sommets, soutenant un système monétaire international doré. Cette époque voit aussi une véritable ruée vers l’or diplomatique, chaque nation cherchant à remplir ses coffres. Par exemple, l’Empire russe accumule des réserves pour renforcer le rouble, tandis que la France reconstitue son stock après l’avoir en partie cédé comme indemnité de guerre à l’Allemagne en 1871. L’or est désormais le soleil autour duquel gravitent les finances mondiales.
Après 1944, le système monétaire international se réinvente à Bretton Woods, mais l’or y conserve un rôle central. Sortant de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis émergent comme le Roi Midas de la finance puisqu’ils détiennent alors près des trois quarts de tout l’or monétaire du monde, environ 20 000 tonnes, dans les coffres de Fort Knox et de la Réserve fédérale. Cette concentration s’explique par l’afflux des réserves européennes envoyées outre-Atlantique pendant la guerre pour les mettre à l’abri du conflit. Ainsi, la Banque d’Angleterre transféra secrètement des centaines de tonnes vers le Canada en 1940 lors de l’opération Fish. L’accord de Bretton Woods consacre alors le dollar comme monnaie pivot, convertible en or au taux fixe de 35$ l’once. En pratique, seule la devise américaine reste directement liée à l’or, les autres monnaies s’arrimant au dollar. Les banques centrales continuent donc de garder de l’or, mais la majeure partie repose désormais dans les coffres américains. L’or devient aussi un instrument de puissance, avec la domination du dollar aussi bon que l’or qui assoit l’hégémonie économique des États-Unis. Quelques esprits frondeurs s’inquiètent néanmoins de confier tant de richesse à un seul État, le général de Gaulle dans les années 1960 exigea le rapatriement de l’or français stocké aux USA, n’hésitant pas à envoyer une frégate charger des lingots à New York et fustigeant le privilège exorbitant du dollar. Dans l’ensemble, l’après-1944 est littéralement l’âge d’or des réserves étatiques, à cette époque, qui détient l’or détient la stabilité et les coffres-forts des banques centrales sont gardés comme des citadelles.
1971 marque un tournant historique, puisque cette année-là, le président Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or, dans ce qu’on appelle le Nixon Shock. Le lien officiel entre les devises et l’or est rompu et les monnaies flottent dorénavant librement. Les réserves d’or des États deviennent dès lors plus symboliques qu’opérationnelles. Nombre de pays, estimant que l’or n’est plus indispensable pour assurer la valeur de leur monnaie, en profitent pour réduire leurs stocks ou les vendre. Le début des années 1970 voit ainsi l’or perdre son auréole sacrée dans les banques centrales. Même si paradoxalement son prix de marché va s’envoler dans la décennie suivante. Les réserves d’or, désormais, ne servent plus à adosser directement la monnaie, mais conservent une fonction de filet de sécurité financier. Certains pays, comme le Canada ou l’Australie, finiront même par vendre la quasi-totalité de leur or dans les décennies suivantes, estimant qu’il vaut mieux investir ces fonds ailleurs. D’autres, au contraire, conserveront précieusement leur magot, par tradition ou prévoyance.

Pourquoi donc, de nos jours, les nations continuent-elles de veiller jalousement sur des tonnes d’or dormant dans des coffres, alors même que cet or n’est plus explicitement lié à la monnaie ? Loin d’être un archaïsme, ces réserves répondent à plusieurs logiques stratégiques.
L’or est souvent qualifié de valeur refuge et c’est bouclier en cas de crise économique. En effet, en période de turbulences géopolitiques ou financières, sa valeur a tendance à rester stable, voire à grimper lorsque tout le reste vacille. Les banques centrales le gardent donc comme assurance ultime. Par exemple, lors de la crise de 2008 ou en cas de panique monétaire, détenir de l’or permet de rassurer les marchés sur la solidité d’un pays. À l’inverse des devises papier qu’une planche à billets peut dévaluer, l’or conserve intrinsèquement sa rareté. C’est un peu le parachute doré des États en cas de chute libre économique. Cette stabilité psychologique explique que même sans étalon-or, on n’ose pas s’en défaire complètement.
Les banques centrales gèrent des réserves de change en dollars, euros, et yen, ainsi que des actifs comme des obligations d’État. L’or, inerte mais fiable, vient diversifier ce portefeuille. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier prend ici tout son sens car si le dollar ou l’euro venait à se déprécier fortement, l’or compenserait en partie la perte. Il a d’ailleurs une corrélation souvent négative avec le dollar, quand ce dernier baisse, l’or monte. Ainsi, détenir par exemple 60% de réserves en devises et 40% en or comme c’est le cas en Allemagne et en France, offre un équilibre prudent. L’or agit comme une police d’assurance financière, certes improductive car il ne porte pas intérêt, mais qui a néanmoins tout son intérêt dans le cadre de la diversification des réserves nationales.
Posséder de vastes réserves d’or confère également une stature particulière sur la scène internationale. C’est une puissance muette mais éloquente, bien présente dans les négociations financières, une forme de puissance diplomatique silencieuse, puisqu’un pays richement doté inspire confiance dans sa solvabilité à long terme. De plus, l’or peut servir de gage dans des accords secrets ou des emprunts d’urgence. Par exemple, pendant la Guerre froide, certaines nations stockaient de l’or hors de leurs frontières pour pouvoir financer un gouvernement en exil au besoin. Aujourd’hui encore, l’or détenu par les États sert d’argument implicite, il témoigne d’une continuité historique et d’une stabilité.
Enfin, la raison peut être plus politique. Certaines nations voient dans l’or une protection contre les incertitudes du système financier global dominé par quelques devises comme le dollar ou l’euro. Détenir son or physiquement, c’est s’affranchir partiellement du réseau bancaire international. Des exemples récents illustrent cette tendance. L’Allemagne, qui conservait durant la Guerre froide une large part de son or dans les coffres de la Fed à New York et de la Banque d’Angleterre, a décidé en 2012 de rapatrier une portion considérable de ses lingots sur le sol allemand. Officiellement, il s’agissait de répondre aux attentes du public et de faire confiance, mais vérifier l’existence tangible de cet or. Ce rapatriement s’est achevé en 2017 pour l’or stocké à Paris et partiellement pour celui des États-Unis. De même, le Venezuela de Hugo Chávez, échaudé par la crise de 2008 et se méfiant des sanctions, a rapatrié en 2011 environ 211 tonnes d’or depuis les coffres de la Banque d’Angleterre et d’autres banques étrangères vers Caracas. La motivation affichée était de protéger le pays en s’assurant que ses avoirs ne puissent être gelés ou saisis en cas de conflit diplomatique. Ironie de l’histoire, quelques années plus tard, une partie de cet or vénézuélien est restée bloquée à Londres pour cause de crise politique, illustrant les limites de la manœuvre. Quoi qu’il en soit, un nombre croissant de pays émergents achètent de l’or pour réduire leur dépendance au dollar et au système de paiements international. La Chine et la Russie notamment ont accumulé frénétiquement des tonnes d’or lors de la dernière décennie, en partie pour se prémunir contre d’éventuelles pressions financières extérieures comme des sanctions économiques ou des guerres commerciales. L’or, actif sans patrie, devient un rempart de souveraineté face aux aléas de la géopolitique monétaire.
Les réserves officielles d’or de chaque pays témoignent à la fois de son histoire monétaire, de ses choix stratégiques et de son poids économique. Au total, environ 36 000 tonnes d’or sont détenues par les banques centrales dans le monde, soit près d’un cinquième de tout l’or jamais extrait. Mais cette répartition est loin d’être égalitaire car une poignée d’États se partagent la majeure partie du magot. Qui sont-ils, où gardent-ils ce trésor et comment ont-ils fait évoluer leurs réserves au fil du temps ?

Le dépôt de Fort Knox dans le Kentucky est l’un des coffres-forts les plus célèbres au monde. Cette forteresse, gardée par l’armée, abrite une grande partie des 8 133 tonnes d’or des États-Unis, accumulées surtout avant 1971.
Avec 8 133,5 tonnes d’or détenues, les États-Unis possèdent de loin la plus grande réserve officielle au monde. Ce pactole représente près de 75% des réserves de change américaines, un pourcentage élevé qui reflète l’héritage du système Bretton Woods. L’or américain est dispersé dans plusieurs lieux ultra-sécurisés à travers le pays, mais le plus iconique est sans doute le Fort Knox dans le Kentucky, coffre-fort fortifié construit en 1936, qui renferme environ la moitié de l’or fédéral, autour de 4 600 tonnes. Le reste est conservé dans d’autres dépôts du Trésor, notamment à West Point à New York et à Denver, ainsi qu’une partie dans la voute souterraine de la Réserve Fédérale de New York, un lieu célèbre situé 25 mètres sous Manhattan, où sont aussi entreposées les réserves de nombreux pays alliés.
Historiquement, la réserve d’or des États-Unis a connu d’énormes variations, de quasi nulle avant 1840, elle enfle avec les ruées vers l’or et la croissance économique, explose après les deux guerres mondiales, le stock atteint un pic d’environ 20 500 tonnes en 1949 lorsque le Trésor encaisse les paiements or de l’Europe, puis fond partiellement dans les années 1950-1960 à mesure que les États-Unis vendent de l’or pour défendre le taux de 35 $/once. De plus, depuis le choc de 1971, paradoxalement l’oncle Sam n’a plus vendu ni acheté d’or notablement, la réserve est donc stable autour de 8133 tonnes depuis quelques décennies.
En 100 ans, l’or américain est passé du statut de fondation du dollar à celui de relique stratégique étant donné qu’il ne garantit plus les billets verts au quotidien, mais qu’il demeure un atout colossal en cas de besoin.
Le Vieux Continent, berceau de l’étalon-or classique, conserve aujourd’hui encore des réserves imposantes, fruit de son passé économique. En Allemagne, les coffres de la Bundesbank abritent 3351,5 tonnes d’or, ce qui place le pays second rang mondial. Cet or, accumulé pendant le miracle économique d’après-guerre avec l’aide indirecte du plan Marshall et des excédents commerciaux, a longtemps été stocké hors d’Allemagne par précaution. Durant la Guerre froide, environ 45% de l’or allemand dormait dans la réserve fédérale de New York, 13% à la Banque d’Angleterre et 11% à la Banque de France, afin de le protéger d’une éventuelle invasion soviétique ou d’un conflit en Europe.
À partir de 2012, devant les interrogations de l’opinion publique, la Bundesbank a lancé un plan pour rapatrier une partie de cet or. Ainsi, l’intégralité des 374 tonnes stockées à Paris a été renvoyée à Francfort en 2017, tandis qu’environ 300 tonnes ont été transférées depuis New York. Désormais, la moitié environ de l’or allemand se trouve de nouveau sur le sol national, le solde restant principalement aux États-Unis avec environ 37% et au Royaume-Uni avec environ 13%. Cette opération, menée discrètement, a mis en lumière l’attachement symbolique de l’Allemagne à son or. En effet, pour un pays marqué par l’hyperinflation des années 1920, ces lingots sont le garant ultime de la stabilité du mark, puis de l’euro made in Germany.
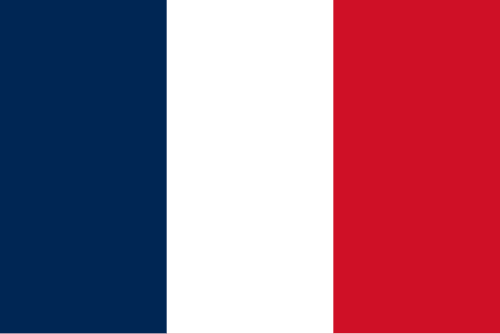
La France n’est pas en reste, avec 2 437 tonnes d’or détenues par la Banque de France, héritage de trois siècles d’histoire monétaire mouvementée. Ce trésor tricolore, troisième plus gros d’Europe, est pour l’essentiel conservé dans une énorme salle forte sous Paris appelée la Souterraine de la Banque de France. Une petite partie était déposée auprès de banques centrales étrangères pour des raisons pratiques de négoce, mais depuis l’ère de Gaulle, la doctrine française est de garder son or à la maison. D’ailleurs, le général de Gaulle a fortement accru les réserves en échangeant des dollars contre de l’or américain en 1965, anticipant ainsi la fin du système de Bretton Woods. Dans les années 2000, la Banque de France a cédé environ 500 tonnes, sous l’impulsion de Jean-Claude Trichet, mais il reste un noyau dur de plus de 2 400 tonnes que Paris semble déterminé à conserver. Historiquement, la France napoléonienne puis républicaine avait déjà amassé d’importants stocks parfois en ponctionnant l’or de nations vaincues, comme l’indemnité exigée à la Prusse en 1807 ou l’or prélevé à l’Italie au XIXᵉ siècle. Sur un horizon de 100 ans, la réserve française a légèrement diminué. En effet, elle était autour de 2 800 tonnes en 1914 et a chuté pendant la Seconde Guerre mondiale, puis elle est remontée et finalement réduite à 2 400 tonnes aujourd’hui.

Citons également l’Italie, autre pilier européen de l’or, avec 2 451,8 tonnes en réserve, un volume comparable à celui de la France. L’Italie doit cette quatrième place mondiale à l’essor économique d’après-guerre et à une politique prudente de sa banque centrale. La Banca d’Italia conserve ces lingots dans ses coffres à Rome, ainsi qu’en partie dans les banques partenaires à l’étranger. Fait intéressant, en Italie le statut de l’or a fait l’objet de débats politiques, appartient-il à l’État ou à la Banque centrale ? Quoi qu’il en soit, aucune vente massive n’est intervenue malgré les dettes élevées du pays, signe que l’or est vu comme un gage fondamental de crédibilité. Un dicton italien prétend même que, tant que nous avons notre or, nous ne tomberons pas. Sur le siècle écoulé, l’Italie est passée d’une situation quasi vide après les déprédations fascistes et les pertes de la guerre, à l’une des plus grandes réserves du monde, grâce notamment aux excédents des années 1950-60 convertis en or. La péninsule a toujours été un pôle du commerce d’or notamment à Venise, Florence avec le florin d’or dès le XIIIᵉ siècle. Mais c’est seulement avec l’unification italienne et la modernité qu’un stock national aussi massif a pu voir le jour.
Le Royaume-Uni, pourtant ancienne superpuissance financière, ne figure qu’au 18ᵉ rang mondial avec 310,2 tonnes d’or. Ce chiffre modeste s’explique en partie par les ventes qu’il a effectuées entre 1999 et 2002, tristement connues outre-Manche sous le nom de Brown’s Bottom, lorsque le chancelier de l’Échiquier de l’époque, Gordon Brown, a vendu près de la moitié des réserves britanniques à un prix historiquement bas. Ces ventes ont réduit le stock du Royaume-Uni d’environ 715 tonnes à un peu plus de 300, une décision encore débattue avec amertume vu l’envolée du cours de l’or par la suite. Il n’en demeure pas moins que la Banque d’Angleterre à Londres reste un acteur central du marché de l’or car ses coffres contiennent ces 310 tonnes d’or nationales, mais aussi des milliers de tonnes appartenant à d’autres pays ou institutions, stockées là pour des raisons de liquidité et de sécurité. Le Londres des Rothschild fut longtemps le cœur du commerce de l’or mondial, fixant quotidiennement le prix du métal selon le mécanisme du London Gold Fixing. En 100 ans, la réserve britannique a fortement baissé, elle dépassait 2 500 tonnes dans les années 1940 quand l’empire était à son zénith monétaire.

Réserve d’or de la Banque d’Angleterre
Enfin, l’Espagne mérite un clin d’œil historique. Actuellement, Madrid détient 281,6 tonnes d’or, un niveau modéré comparé à ses voisins, conséquence notamment de ventes réalisées dans les années 2000 pour diversifier ses réserves. Pourtant, si l’on remonte 500 ans en arrière, l’Espagne était la nation la plus riche en or et en argent au monde, grâce aux trésors amassés dans les Amériques. Au XIXᵉ siècle, l’Espagne perdit ses colonies et ses réserves fondirent au gré des crises. Sur les 10 dernières années, sa réserve est restée relativement stable, après la vente de 200 tonnes en 2005-2007, il lui reste ses 281 t actuelles. L’or espagnol est conservé principalement à la Banco de España à Madrid. Fait historique notable, durant la guerre civile espagnole de 1936-39, une grande partie de l’or de la Banque d’Espagne, le légendaire or de Moscou, a été envoyé en URSS par le gouvernement républicain pour le mettre à l’abri et n’est jamais revenu. Ainsi, l’histoire chaotique de l’or espagnol reflète celle du pays, des galions de l’empire aux coffres socialistes, en passant par des ventes modernes, l’Espagne a tout connu avec son or.
Le continent asiatique, jadis importateur d’or massif est aujourd’hui au cœur du marché de l’or, tant du côté de la demande privée que des réserves publiques.

Commençons par la Chine, la deuxième puissance économique mondiale qui affiche officiellement 2 279,6 tonnes d’or en réserve, ce qui la place au 6ᵉ rang. Cependant, beaucoup suspectent que la Chine possède en réalité bien plus d’or que ne le disent ses déclarations officielles. La Banque populaire de Chine a longtemps joué à cache-cache avec le marché, ne révélant que par à-coups ses achats d’or. En 2015, Pékin a brusquement annoncé une hausse de +57% de ses réserves, les faisant passer de 1 054 tonnes à 1 658. Depuis, elle communique plus régulièrement et achète presque chaque mois. Sur la seule année 2019, la Chine a acheté plus de 100 tonnes d’or. Ces acquisitions visent à diversifier ses immenses réserves de change, estimées à près de 3 000 milliards de dollas, principalement en bons du Trésor US et à se prémunir contre d’éventuelles sanctions ou chocs externes. L’or chinois est gardé majoritairement sur le sol national, vraisemblablement dans les coffres de la banque centrale à Pékin et Shanghai, bien que les détails soit secret d’État.
Historiquement, la Chine impériale disposait d’énormes quantités d’or et d’argent, notamment grâce aux échanges commerciaux avec l’Europe via la Compagnie des Indes, mais la Chine communiste de 1949 était appauvrie en or. En 1980, elle n’en détenait qu’environ 400 tonnes. La fulgurante ascension économique chinoise s’est accompagnée d’une frénésie d’achat d’or depuis 20 ans. Sur 10 ans, ses réserves ont plus que doublé. Sur 100 ans, la transformation est radicale puisque d’importateur net, le pays est devenu un géant qui amasse pour ne plus dépendre de l’Occident.
Non loin derrière la Chine, la Russie détient 2 332,7 tonnes d’or, occupant ainsi le 5ᵉ rang mondial. C’est peut-être le cas le plus frappant de réorientation stratégique récente carepuis les années 2000, et surtout après 2014, la Banque de Russie a accumulé de l’or à un rythme effréné profitant notamment de ses revenus d’exportation de pétrole et de gaz. En 2000, la Russie n’avait qu’environ 400 tonnes d’or, en 2010 environ 750 et en 2020 plus de 2 300 tonnes. Cette multiplication par cinq en deux décennies témoigne d’une volonté délibérée de se désarrimer du dollar. La majorité de l’or russe est conservée à Moscou et Saint-Pétersbourg, sous la garde rapprochée de la banque centrale de Russie. Fait révélateur, en 2018 la Russie a vendu la quasi-totalité de ses bons du Trésor américain et simultanément accru ses lingots d’or, anticipant des sanctions qui tomberaient après 2022. Sur un siècle, la Russie est revenue à un niveau proche de celui de l’Empire tsariste. En 1914, l’empire russe était le deuxième détenteur d’or au monde, mais ces réserves disparurent en grande partie pendant la Révolution et sous Staline. De plus, sur un millénaire, la Russie ancienne n’avait pas de réserves d’or notables, payant tribut aux Mongols en fourrures plus qu’en or. L’histoire récente a donc vu la Russie faire un retour en force sur la scène de l’or, dans un curieux remake moderne de la guerre froide monétaire.

En Asie du Sud, l’Inde mérite un chapitre à part. Officiellement, l’Inde détient 876,1 tonnes d’or, ce qui la place au 9ᵉ rang mondial. Une partie de ce stock est conservée dans les voûtes de la Reserve Bank à Bombay, tandis qu’une autre est entreposée à l’étranger, notamment à la Banque d’Angleterre, pour faciliter les transactions. Mais l’Inde, c’est surtout un cas unique où l’or culturellement vénéré abonde sous forme privée : les ménages indiens cumuleraient plus de 25 000 tonnes en bijoux, pièces et lingots, soit la plus grande réserve officieuse au monde ! Ce paradoxe fait que l’Inde a souvent eu des difficultés de balance des paiements car elle importe l’or que ses citoyens thésaurisent. Pour les réserves officielles, la banque centrale indienne a fait quelques achats notables, comme en 2009 lorsqu’elle racheta 200 tonnes au FMI. Sur 10 ans, l’Inde a augmenté modestement ses réserves d’or autour de + 150 tonnes. Le sous-continent a toujours attiré l’or, les marchands romains disaient déjà que l’or allait toujours vers l’Inde en échange des épices et des soieries. Aujourd’hui, c’est la banque centrale qui en détient une part importante pour le compte de la nation.
Le Japon, troisième économie mondiale, possède 845,9 tonnes d’or se plaçant au 10ᵉ rang. Son cas est intéressant car le Japon moderne a dû repartir de zéro après 1945, ses réserves d’or avaient été quasiment anéanties pendant la guerre. Grâce au boom économique des décennies suivantes, la Banque du Japon a reconstitué un stock considérable. Dans les années 1950-60, Tokyo a acheté de l’or notamment pour diversifier ses énormes réserves de dollars issues de ses excédents commerciaux. Aujourd’hui, ces 846 t sont un pilier secondaire des réserves japonaises. Elles ne représentent qu’environ 6% des réserves totales du pays, le reste étant surtout des bons en dollars. Le Japon a même vendu une petite portion de son or en 2021 pour injecter des liquidités face à la pandémie, mais prévoit de le racheter ensuite. La plupart de l’or nippon est gardé à la Banque du Japon à Tokyo, et peut-être en partie dans des institutions outre-mer pour en faciliter l’usage. Sur un siècle, le Japon est monté puis descendu : il figurait dans le top 5 mondial dans les années 1980 quand ses réserves approchaient 750 t, a légèrement baissé, puis stabilisé. Sur un millénaire, le Japon féodal considérait l’or comme un métal précieux mais secondaire. Le riz et l’argent servaient alors de principales monnaies d’échange. Ce n’est qu’à partir de l’ère Meiji, puis surtout après la Seconde Guerre mondiale, que l’or a pleinement intégré la panoplie financière du pays du Soleil-Levant.
D’autres pays d’Asie occidentale méritent mention. La Turquie a fortement accru ses réserves ces dernières années, atteignant autour de 765 tonnes en 2023. Fait particulier, une partie de l’or turc correspond à l’or que les banques commerciales sont tenues de déposer auprès de la banque centrale, dans le cadre de la politique de réserve obligatoire en or. Ce mécanisme fait fluctuer le niveau des réserves déclarées. Néanmoins, Ankara a rapatrié tout son or stocké à l’étranger suite aux tensions avec les États-Unis, et continue d’en acheter. L’Arabie saoudite détient quant à elle 323 tonnes, fruit des pétrodollars recyclés en lingots dans les années 1970.
Avec respectivement 284 tonnes pour le Kazakhstan et 382 tonnes pour l’Ouzbékistan, ces deux pays riches en mines aurifères ont constitué d’importantes réserves, en grande partie grâce à l’achat de leur propre production nationale. Globalement, on observe qu’en Asie, hors Japon, les réserves d’or officielles étaient modestes il y a 30 ans, puis se sont envolées récemment : la part de l’Asie dans l’or des banques centrales est passée d’environ 10% en 1990 à plus de 20% aujourd’hui. C’est un basculement discret mais considérable du centre de gravité financier mondial vers l’Est.
Le continent africain, pourtant berceau de grands gisements d’or et d’empires légendaires comme le Ghana médiéval ou le Mali de Mansa Musa, ne se distingue pas aujourd’hui par l’ampleur de ses réserves officielles. Cela s’explique par l’histoire coloniale qui a vu l’or extrait d’Afrique expédié en Europe et par le fait que nombre de pays africains ont longtemps délégué leur politique monétaire. Néanmoins, quelques États se distinguent.
L’Algérie possède la plus grande réserve d’or du continent avec 173,6 tonnes. Héritage en partie de l’ère Boumédiène où, grâce aux revenus pétroliers, l’Algérie a converti des dollars en or, cette réserve est précieusement gardée par la Banque d’Algérie. Alger n’a ni vendu ni accru significativement ce stock depuis des années, le considérant comme un fonds de stabilité stratégique. On note qu’elle représente près de 18% des réserves totales du pays.

L’Afrique du Sud, ancienne championne mondiale de la production aurifère, ne conserve curieusement que 125,4 tonnes d’or. La Reserve Bank sud-africaine a en effet peu augmenté ses avoirs, voire en a cédé une partie dans les années 1990 pour soutenir le rand. Il faut dire que l’économie sud-africaine, bien qu’ayant extrait plus de 50 000 tonnes d’or de ses mines en un siècle, a préféré exporter ce métal contre devises plutôt que de l’entasser dans ses coffres. Aujourd’hui, ses réserves restent stables et représentent environ 16% de ses actifs de réserve, stockées principalement à Prétoria.
La Libye détenait 146,7 tonnes, avant 2011. Ce stock est largement hérité de Kadhafi qui aimait avoir un coffre-fort indépendant. Depuis le chaos libyen, le statut exact de ces 147 t est flou. Une partie serait entreposée à l’étranger, une autre partie aurait pu être vendue ou pillée durant la guerre civile.
En ce qui concerne l’Égypte, le pays a récemment augmenté son or à 126,5 tonnes, reflétant la volonté du Caire de rassurer les investisseurs alors que la livre égyptienne se déprécie. Citons aussi des pays comme le Maroc avec environ 22 t, la Tunisie avec environ 6,8 t ou le Nigeria avec environ 21 t qui gardent quelques lingots en réserve, souvent vestiges de périodes anciennes ou achats symboliques. Sur l’échelle de 1000 ans, l’or d’Afrique a surtout brillé par son exportation : les trésors de Tombouctou, du Monomotapa ou d’Akan sont partis orner les églises et palais d’Europe et d’Asie. Aujourd’hui, en 2025, l’ensemble du continent africain hors Afrique du Sud ne détient officiellement qu’environ 600 tonnes d’or, soit moins que la réserve de la Banque de France seule. C’est l’un des paradoxes persistants de la richesse minérale contre la pauvreté financière.
Néanmoins, plusieurs pays africains producteurs, tels que le Ghana, la Tanzanie et le Mali, envisagent d’augmenter légèrement leurs réserves afin de renforcer leur souveraineté monétaire à l’avenir. Un signe que la leçon de Mansa Musa n’a pas été totalement oubliée.
L’Amérique du Sud, terre d’El Dorado pour les conquistadors, affiche aujourd’hui des situations contrastées quant à l’or des banques centrales.

Le pays le mieux doté du sous-continent est le Venezuela avec 161,2 tonnes. Ce montant a toutefois beaucoup varié ces dernières années du fait de la profonde crise économique vénézuélienne. L’or a servi de planche de salut : Caracas a vendu ou hypothéqué une partie de ses lingots pour obtenir des devises et rembourser ses dettes. En 2011, comme mentionné, Hugo Chávez avait rapatrié la quasi-totalité de l’orvénézuélien stocké à l’étranger, estimé à environ 211 t, exaltant la souveraineté retrouvée. Ironiquement, dans les années 2020, une portion de cet or s’est retrouvée bloquée à Londres du fait des sanctions et du différend sur la légitimité du gouvernement Maduro, tandis qu’une autre portion aurait été discrètement vendue aux Émirats ou en Turquie pour financer l’État. Il resterait donc environ 161 t dans les comptes officiels, principalement entreposées dans les coffres de la Banque centrale à Caracas. Sur 10 ans, le Venezuela a vu fondre son pactole qui dépassait les 360 t en 2013. Sur 100 ans, c’est assez tragique : autrefois l’un des pays les plus riches en or grâce aux concessions minières du Banco Central dans l’Orénoque, etc., il a dû aliéner son trésor pour survivre.
Le Brésil, géant économique de la région, détient pour sa part 129,6 tonnes d’or. Cette réserve était longtemps restée autour de 50 t, puis la banque centrale brésilienne a surpris les marchés en 2021 en achetant 62 tonnes supplémentaires en quelques mois, doublant quasiment son stock. Le Brésil a ainsi franchi le cap symbolique des 100 t, signe d’une volonté de diversification. L’or brésilien est gardé en partie à Brasilia et São Paulo, et possiblement en partie dans des places financières comme Londres pour pouvoir être mobilisé rapidement en cas de besoin. Historiquement, le Brésil a produit énormément d’or. En effet, les ruées vers l’or au Minas Gerais au XVIIIᵉ siècle alimentaient le trésor portugais.
Cependant, à l’époque coloniale, cet or prenait principalement le chemin de Lisbonne. Au XXᵉ siècle, le Brésil indépendant a eu des réserves volatiles, utilisant son or parfois en garantie de prêts lors de crises comme dans les années 1980 par exemple. Sur 10 ans, son stock a nettement augmenté avec +50%. Sur 100 ans, les réserves d’or du Brésil ont fluctué au rythme de son économie, notamment à la baisse durant les décennies marquées par une forte inflation. Sur 500 ans, on peut dire que l’or brésilien a surtout profité à d’autres, comme les cours de Versailles sous Louis XIV, ornés en partie grâce à l’or du Brésil passé par le Portugal. Aujourd’hui, Brasilia semble vouloir conserver davantage cette richesse sur son propre sol.

L’Argentine, quant à elle, possède officiellement 61,7 tonnes d’or. Ce chiffre relativement modeste cache des tribulations dignes d’un tango. L’Argentine a vendu une grande partie de son or dans les années 1990 sous le règne de Menem, lorsque le pays arrima son peso au dollar et jugea l’or obsolète. À la suite de la crise de 2001, Buenos Aires a recommencé à acheter un peu d’or dans les années 2000, remontant de 20 t à plus de 60 t. Cependant, face aux difficultés persistantes, il y a eu des rumeurs régulières de cessions ou de mises en gage de l’or argentin pour obtenir des prêts internationaux. En 2016, par exemple, la banque centrale argentine a utilisé l’or comme collatéral pour un swap avec la Banque des Règlements Internationaux. La majeure partie des lingots argentins seraient conservés à l’étranger, en particulier à Londres et à New York, pour faciliter ce genre d’opérations, plutôt que dans les caves de la Banco Central à Buenos Aires. Sur une décennie, les réserves ont légèrement augmenté puis se sont stabilisées autour de 61 t. Sur un siècle, l’Argentine est passée littéralement par tous les états : riche dans les années 1940 quand Perón se targuait d’avoir des coffres pleins d’or grâce aux exportations agricoles pendant la guerre, quasiment sans or dans les années 1990, et à nouveau un petit matelas aujourd’hui. Sur le long terme, malgré son nom signifiant « argent », l’Argentine n’a jamais vraiment regorgé d’or, mais elle s’efforce d’en garder un peu comme bouée monétaire dans sa mer agitée.
En élargissant le panorama sud-américain, notons que le Mexique, certes en Amérique du Nord géographiquement mais latino-culturel, détient 120,3 t. Le Mexique a d’ailleurs acheté 100 t d’un coup en 2011, profitant des réserves accumulées de devises pétrolières. La Colombie a environ 10 t, le Pérou autour de 34 t, le Chili 0 t ayant tout vendu dans les années 1990. Beaucoup de pays d’Amérique latine ont d’ailleurs vendu leur or dans les périodes où ils étaient sous programme du FMI, privilégiant les liquidités. Cependant, depuis 2020, on observe un frémissement : plusieurs banques centrales de la région comme le Pérou, l’Argentine et le Brésil songent à augmenter leurs réserves d’or pour se protéger contre la dévaluation du dollar. C’est un renversement timide de la tendance précédente.
En somme, les réserves d’or actuelles des États racontent une histoire vivante faite de gloires passées, de choix stratégiques et parfois d’anecdotes surprenantes. Sur la perspective des 10 dernières années, la plupart des banques centrales du monde, après deux décennies de ventes nettes, sont redevenues acheteuses nettes d’or. En particulier la Russie, la Chine, la Turquie, l’Inde et le Kazakhstan figurent parmi les principaux acheteurs d’or de ces dernières années.
À l’inverse, très peu de pays revendent leurs réserves, à l’exception de la Turquie, qui le fait parfois pour soutenir sa monnaie, et de quelques États européens cédant de faibles volumes. Sur 100 ans, on constate que les grands perdants en part relative sont le Royaume-Uni et les anciennes puissances coloniales. En effet, leurs stocks ont baissé ou stagné pendant que d’autres montaient, et les grands gagnants sont les nations émergentes comme la Chine ou encore l’Inde qui ont pris une place considérable. Les États-Unis et l’Europe occidentale conservent malgré tout le noyau dur de l’or mondial avec environ la moitié du total, reflétant l’inertie historique. Sur 1000 ans, si l’on osait un détour, on noterait que l’or a voyagé : ce qui était entassé dans les temples antiques a fini dans les banques centrales modernes. Le trésor d’Athènes, l’or des conquistadors, le pillage des empires et les lingots de Fort Knox ne sont que des chapitres d’une même saga dorée.
En conclusion, l’histoire des réserves d’or des États est un véritable roman d’aventures à travers le temps et le globe. De l’oracle de Delphes aux coffres numériques des banques centrales actuelles, l’or conserve une aura quasi mystique. Qu’il soit symbole de puissance, assurance en cas de tempête ou simple héritage du passé, ce métal inaltérable continue de lier entre elles les époques et les nations. Comme le disait fort à propos un banquier central facétieux : « Les dieux de l’Olympe ne sont plus, mais l’or reste notre fidèle gardien ». Et il est vrai qu’au fond de leurs souterrains, les lingots silencieux veillent, témoins immobiles de la grandeur et des déboires des États, prêts à écrire les prochains chapitres d’une histoire millénaire.

L’or dépasse pour la première fois les 5000 dollars l’once !
Le cours de l’or a atteint, dans la nuit du 25 au 26 janvier...

L’évolution du cours de l’argent au fil du temps
Un métal précieux en pleine évolution : Pourquoi investir dans l’argent ? L’argent est...

La réserve d’or de la Banque de France : Un trésor caché
La réserve d’or en France en euros. La France possède une réserve d’or d’une valeur...
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.